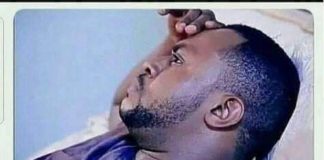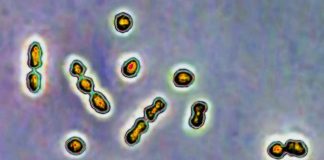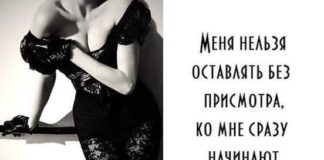De nouvelles recherches suggèrent que donner aux individus plus de liberté dans les situations sociales peut accroître considérablement la coopération, la confiance et l’équité. L’étude internationale, à laquelle participent des chercheurs de l’Université de Kobe, remet en question les hypothèses des expériences traditionnelles sur le comportement humain. Publié dans Nature Human Behaviour, il affirme que ces configurations standards sous-estiment souvent nos tendances prosociales inhérentes.
Les scientifiques utilisent des jeux inspirés des interactions sociales réelles pour comprendre comment les gens se comportent dans des situations spécifiques. Par exemple, un « jeu de coopération » courant montre que seulement environ un individu sur sept coopère de manière cohérente au fil du temps. Cela suggère un comportement prosocial limité dans des environnements structurés.
Cependant, les expériences traditionnelles supposent généralement que les joueurs doivent agir de la même manière envers toutes les personnes avec lesquelles ils interagissent. Cela néglige un aspect crucial de l’interaction humaine : notre capacité à adapter notre comportement en fonction des relations individuelles.
“La plupart des jeux en réseau supposent l’uniformité”, explique Ivan Romić, spécialiste des sciences sociales à l’université de Kobe. “Ils ne tiennent pas compte du fait que les humains gèrent activement leurs réseaux sociaux.”
Pour combler cette lacune, Romić et ses collègues – Danyang Jia et Zhen Wang de l’Université polytechnique du Nord-Ouest à Xi’an, en Chine – ont conçu une nouvelle configuration expérimentale. Cela a permis aux participants de choisir différentes actions en fonction de la personne avec laquelle ils interagissaient dans les jeux classiques « Dilemme du prisonnier » et « Confiance et ultimatum », des scénarios souvent utilisés pour modéliser la coopération et l’équité.
Plus de 2 000 étudiants universitaires à travers la Chine ont participé à ces jeux modifiés. Les chercheurs ont varié le degré de liberté accordé aux joueurs, leur permettant d’observer l’impact de cela sur les résultats.
Les résultats ont été frappants. Dans le « dilemme du prisonnier », les taux de coopération sont passés de seulement 14 % lorsque les participants avaient des choix limités à plus de 80 % lorsque chacun pouvait personnaliser ses interactions. La confiance et l’équité ont connu des augmentations spectaculaires similaires. Même dans les groupes mixtes où seuls quelques joueurs disposaient de cette flexibilité, le comportement prosocial s’est considérablement amélioré.
Il est intéressant de noter que l’introduction initiale de la liberté a entraîné une augmentation temporaire des inégalités à mesure que des acteurs plus adaptables exploitaient leur avantage. Cependant, en fin de compte, à mesure que les jeux progressaient et que tous les joueurs bénéficiaient de la liberté d’adapter leurs actions, les inégalités ont diminué alors même que la richesse globale augmentait.
“Les joueurs ayant plus de liberté ont montré dès le début des tendances prosociales”, explique Jia, co-auteur de l’étude. “Il ne s’agissait pas seulement d’apprendre au fil du temps ; ils avaient la capacité d’agir différemment dès le départ.”
L’équipe a observé qu’à mesure que les participants gagnaient en agence, les groupes se tournaient vers des stratégies coopératives telles que le « du tac au tac » – où la coopération est réciproque – et vers des fiduciaires généreux qui offraient volontiers leur confiance. À l’inverse, ceux qui sont contraints par des choix limités se tournent souvent vers des actions moins coopératives, pas nécessairement parce qu’ils sont égoïstes, mais simplement parce que leur environnement ne leur permet pas de meilleures options.
Les chercheurs concluent que de nombreuses expériences traditionnelles sous-estiment le potentiel de coopération humaine en limitant la manière dont les individus peuvent prendre des décisions sociales. Ils soutiennent que les futures recherches comportementales devraient refléter la réalité des interactions personnalisées et de l’adaptation individuelle au sein des réseaux sociaux afin de saisir avec précision les complexités du comportement humain.
“Cela suggère”, souligne Romić, “que l’égalité des chances en matière d’interactions individualisées profite au comportement prosocial”.