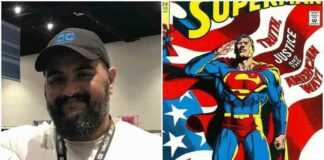Des milliers d’Autochtones sont descendus à Belém, au Brésil, pour le sommet sur le climat COP30, marquant une présence record de ce groupe démographique crucial. Leur arrivée n’était pas une coïncidence ; Le Brésil a stratégiquement choisi la ville amazonienne pour souligner l’impact dévastateur du changement climatique sur ces communautés. Cette année, leur message unifié a résonné haut et fort : les voix autochtones doivent avoir la priorité dans les négociations mondiales sur le climat.
L’ampleur de leur participation a envoyé un message puissant. Les participants sont venus de toute l’Amérique latine, notamment des Andes équatoriennes et de la forêt amazonienne du Pérou, se réunissant avec des militants des diverses régions forestières et de savane du Brésil. Ils sont venus ensemble pour réclamer la reconnaissance de leur rôle vital dans la sauvegarde de la planète.
« Le temps presse », a déclaré Katty Gualinga, une jeune leader autochtone de 25 ans originaire d’Équateur, qui a bravé un voyage épuisant en bus et en bateau pour atteindre Belém. “Les forêts s’assèchent. La chaleur augmente. Néanmoins, c’est nous qui protégeons la vie dans la forêt.”
Leur présence était alimentée par l’urgence. Les communautés autochtones sont confrontées à des menaces immédiates telles que la déforestation généralisée provoquée par l’exploitation aurifère et le forage pétrolier. Ces activités détruisent non seulement leurs terres ancestrales, mais libèrent également de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, exacerbant ainsi le réchauffement climatique. Cette expérience collective de la dévastation climatique en première ligne les a propulsés aux portes de la COP30.
Au-delà de la simple mise en lumière des souffrances, ils sont venus armés de solutions. Ils sont déjà à l’avant-garde des efforts de conservation, protégeant méticuleusement certaines des forêts les plus riches en biodiversité de la planète – des écosystèmes essentiels pour absorber le carbone et atténuer les impacts climatiques plus larges. Leurs connaissances traditionnelles offrent des informations inestimables sur la gestion durable des terres et l’utilisation des ressources, des stratégies qui pourraient avoir un poids significatif dans les discussions politiques mondiales sur le climat.
L’arrivée du contingent indigène à Belém a envoyé un message fort : leur combat est intrinsèquement lié au sort de la planète. Leur demande de reconnaissance ne concerne pas seulement la participation politique ; il s’agit d’intégrer les connaissances et les pratiques autochtones dans les solutions climatiques mondiales, garantissant ainsi que les générations futures hériteront d’une Terre habitable.